Derrière ce regard d’acier, cette mâchoire serrée qui incarnait la droiture et la force tranquille du cinéma français, il y avait un homme en guerre. Pas une guerre spectaculaire, mais une guerre intime, silencieuse, contre un monde qu’il jugeait trop souvent faux. Lino Ventura, le roc, le symbole de la loyauté, portait en lui une accumulation de blessures invisibles. Sur les plateaux, il était le “Gorille”, le “Tonton Flingueur”, l’homme d’une parole. Mais dès que la caméra s’éteignait, c’était un autre homme, plus complexe, qui reprenait ses droits.
À 67 ans, alors que la France entière le célébrait comme un monument d’intégrité, Lino se tenait face à un inventaire qu’il ne pouvait plus repousser : celui des rancunes. Cinq noms, cinq visages, cinq situations gravées dans sa mémoire comme des cicatrices que le temps n’avait pas refermées. Ventura n’était pas un homme d’explosion ; il était un homme de retenue. Il n’enterrait pas sa colère, il la transformait en une fierté froide, un mur de silence. Il ne pardonnait pas. Non par orgueil pur, mais parce qu’il voyait dans le pardon une trahison envers lui-même. Pour lui, pardonner, c’était effacer la vérité. Et la vérité, chez Lino Ventura, n’était jamais négociable.
Pour comprendre cette intransigeance presque primitive, il faut rembobiner. Revenir non pas au début de sa carrière, mais à sa naissance. Angiolino Joseph Ventura, né à Parme en 1919, dans une Italie pauvre. Le manque de tout : d’argent, de certitudes, et surtout, de père. C’est sa mère, femme courageuse, qui l’emmène en France, à Montreuil, dans l’espoir d’un avenir. Mais la France des années 30 est dure avec les immigrés. Le jeune Lino apprend la langue à coups d’humiliations et de bagarres de cour d’école.
Cette expérience fondatrice forge l’homme. Il ne demandera jamais la reconnaissance, il l’obtiendra par la force et le travail. Il voit sa mère trimer, subir les regards condescendants, mais ne jamais se plaindre. Ce modèle de dignité devient le socle de sa morale. Lino Ventura ne pardonnera jamais aux arrogants, aux puissants, à ceux qui humilient. Chaque blessure d’orgueil, chaque mépris de critique, chaque parole en l’air d’un producteur le renverra à ce passé d’enfant immigré méprisé. Le silence devient son arme, le regard son bouclier. Avant d’être acteur, il sera lutteur, un sport brutal mais codifié qui lui apprend la maîtrise. Le cinéma viendra par hasard, mais ce rôle d’étranger qui doit prouver sa place, il ne le quittera jamais.

Quand Jacques Becker le remarque pour “Touchez pas au Grisbi”, le cinéma français découvre une anomalie. Ventura n’a pas les codes, il ne joue pas, il “est”. Sa voix grave, sa lenteur maîtrisée, sa vérité brute tranchent avec un milieu de séduction et de bavardage. Le public l’adopte immédiatement. Il devient l’incarnation d’une France populaire, celle des hommes fatigués mais debout. Il impose la force du silence. Mais Ventura reste un étranger dans cette “famille”. Il fuit les fêtes, les tapis rouges, les compliments intéressés. Il se protège du vacarme, car il sait que trop de bruit étouffe la sincérité.
Cette droiture devient sa marque de fabrique, mais aussi sa malédiction. Car à mesure que son succès grandit, les fractures apparaissent. Les années 70 voient émerger la Nouvelle Vague. Truffaut, Godard… des réalisateurs qu’il respecte mais dont il se méfie. Il sent que leur cinéma, plus cérébral, ne parle plus au peuple mais à une élite. “Quand on oublie le spectateur, on oublie la raison d’exister d’un film,” confie-t-il. La blessure se creuse. C’est là que naissent les rancunes qui le définiront.
La première trahison est celle des critiques, notamment ceux des “Cahiers du Cinéma”. Fascinés par la modernité, ils commencent à le juger “daté”. On l’accuse de rejouer toujours le même personnage. Pour Ventura, qui voit dans cette fidélité une forme d’honnêteté, le mépris est total. Il lit les articles, les garde, n’oublie jamais. Cette douleur réveille celle du petit immigré jugé, jamais totalement accepté.
La deuxième est plus intime : Jacques Becker. L’homme qui l’a révélé. Ventura ne supportait pas qu’on le réduise à une “création” de quelqu’un d’autre. “Je me suis fait tout seul,” disait-il. Non par ingratitude, mais par une peur viscérale d’être redevable.
La troisième est une rivalité silencieuse avec une autre icône : Jean Gabin. Son alter ego, son double d’écran. Mythiques dans “Le Clan des Siciliens”, leur entente était fragile. Gabin, autoritaire, aimait dominer. Ventura, respectueux mais fier, souffrait de cette hiérarchie. “Sur le plateau, il n’y avait de place que pour lui,” confiera-t-il, amer. Une déception à la hauteur de l’admiration qu’il lui portait.
La quatrième est un acte public, un refus qui fera date : la Légion d’honneur. Le gouvernement insiste, lui refuse. À ses yeux, cette médaille n’est qu’un “ruban politique”. “Je n’ai rien fait pour mériter ça,” répond-il. Ce geste, rare, choque autant qu’il fascine. Il préfère la solitude au mensonge d’État.
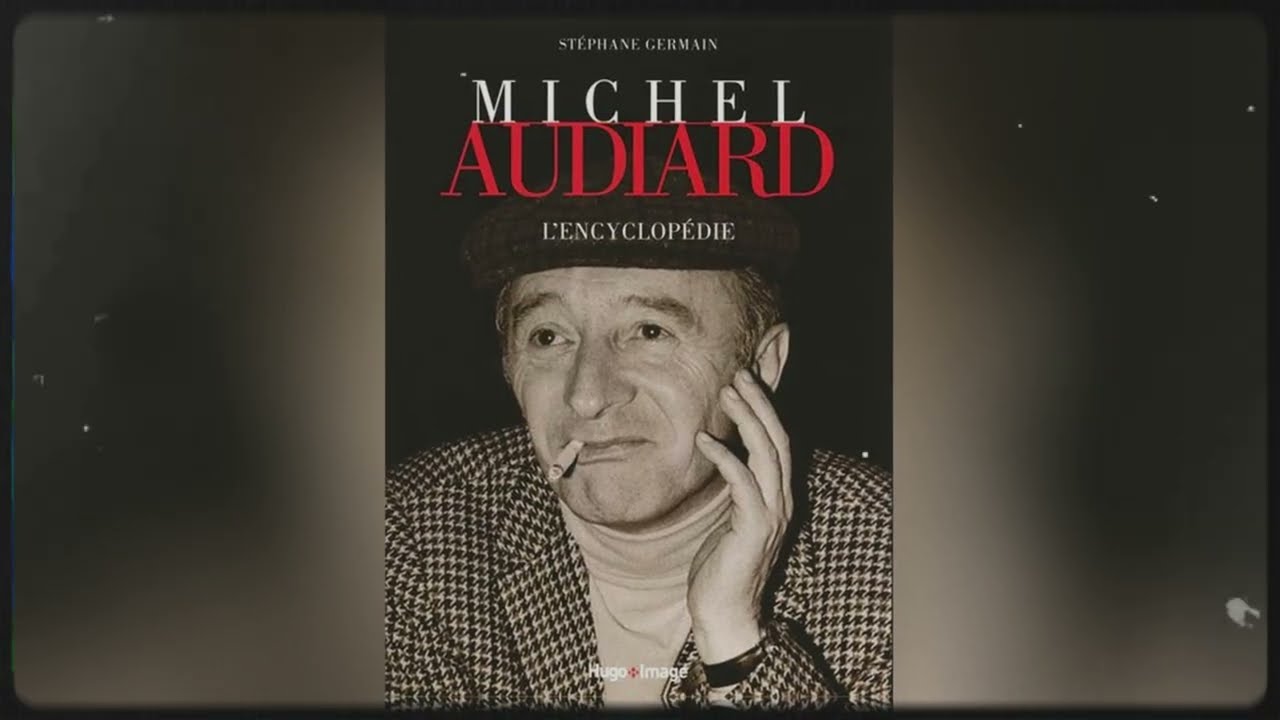
Enfin, la cinquième trahison est celle de la presse. Ces journaux qui l’ont méprisé à ses débuts avant de l’encenser. Ventura lit tout, range les articles, garde la mémoire des injures. Lorsqu’un journaliste auteur d’une critique injuste tente de l’interviewer, il répond froidement : “J’ai de la mémoire, moi.” Le ton est donné.
Ces rancunes ne sont pas des haines spectaculaires. Ce sont des silences tenaces, des retraits. Sa vengeance, c’est l’oubli volontaire. Dans son monde, le respect perdu ne se regagne jamais. Mais réduire Ventura à son austérité serait une erreur. Car s’il ne pardonne pas, il ne hait pas. Il transforme sa douleur en action. En 1966, avec sa femme Odette, il fonde Perce-Neige, une association pour les enfants handicapés, inspirée par leur fille Linda. C’est là, loin des caméras, que le colosse exprime sa tendresse. Il ne dit pas “je t’aime”, il construit des murs pour protéger ceux qu’il aime.
Les années 80 l’isolent. Le cinéma s’américanise, les carrières se gèrent comme des marques. Lui continue de dire non. En 1985, un grand festival l’invite pour un prix d’honneur. Il apprend que deux critiques qu’il méprise sont dans le jury. Il se retire à la dernière minute. Aucun communiqué. Juste un silence, son acte de fidélité ultime à lui-même. “Les seuls prix qui comptent, ce sont les regards dans la rue,” dit-il.
Le 22 octobre 1987, il s’éteint d’une crise cardiaque. Un départ à son image : sobre, digne, sans caméra. À ses funérailles, pas de parterre de stars, mais la famille et les enfants de Perce-Neige. Ironie tragique, c’est en disparaissant qu’il obtient l’unanimité qu’il avait toujours refusée. La République lui remet la Légion d’honneur à titre posthume. Odette accepte, non pour lui, mais pour ce qu’il a représenté.
L’héritage de Lino Ventura est là. Plus qu’une carrière, c’est une leçon de cohérence. Il nous rappelle qu’un homme ne se définit pas par ce qu’il dit, mais par ce qu’il tient. N’a-t-il jamais pardonné ? C’est vrai. Mais c’est peut-être cette fidélité farouche à ses propres blessures qui le rend si profondément humain. Il n’a jamais cherché à être aimé ; il a exigé d’être droit. Et cette exigence, simple et intransigeante, fait de lui une légende que le temps ne peut pas effacer.

News
Nolwenn Leroy : Les Révélations Poignantes de ses 42 ans sur “l’Amour de sa Vie”
Dans l’univers parfois impitoyable du show-business français, rares sont les artistes qui parviennent à maintenir une frontière étanche entre les…
Julio Iglesias à 81 ans : Entre aveux sincères, secrets de famille et vérité sur sa santé, la légende se livre enfin
Julio Iglesias n’est pas seulement une voix ; il est un mythe vivant, une icône de la romance qui a…
Isabelle Nanty : Le combat secret d’une icône entre la vie et la mort après une hospitalisation critique
Le monde du cinéma français a retenu son souffle. Isabelle Nanty, figure emblématique et solaire de nos écrans, a traversé…
CLASH EXPLOSIF : Louis Boyard et Apolline de Malherbe, le duel qui a embrasé le direct !
L’arène médiatique a tremblé ce matin. Ce qui devait être une interview politique classique s’est transformé en un véritable champ…
Jean-Pierre Foucault en deuil : Les adieux déchirants à Marie-José Tramoni, la seule femme qu’il ait jamais épousée
Le paysage médiatique français est en émoi. Derrière l’image de l’animateur infatigable, toujours prêt à distribuer sourires et bonne humeur…
Sarah Knafo “rhabille” la gauche : le choc des vérités sur le Venezuela !
Le séisme politique : Sarah Knafo face à l’aveuglement idéologique Le paysage médiatique français vient d’être le théâtre d’une déflagration…
End of content
No more pages to load












