Pendant plus de dix ans, il a plongé dans les abysses du trafic de stupéfiants, côtoyant la mort, la misère et l’ingéniosité sans limite des criminels. Jean-Pierre Colombies, ancien policier de la brigade des stups à Paris puis à Marseille, sort de son devoir de réserve pour livrer un témoignage ahurissant sur un monde parallèle, où la frontière entre le bien et le mal est “très mince”. Des années 80 aux portes du nouveau millénaire, il a vécu une “aventure” que l’on ne retrouve plus aujourd’hui, un quotidien “hors norme” qu’il déconseille aujourd’hui à tout jeune policier, car pour lui, le milieu des stups est “l’un des milieux les plus pourris qu’il soit”.
Un monde sans limite : l’imagination des trafiquants

“Le monde des stupéfiants est un monde sans limite en termes d’imagination”, confie Jean-Pierre Colombies. Les trafiquants, loin d’être des “crétins”, sont de véritables “businessmans” qui s’adaptent avec une fluidité déconcertante aux stratégies policières. Face à un produit interdit, l’attractivité augmente, un phénomène que Colombies compare à la prohibition aux États-Unis, où la consommation d’alcool n’a jamais été aussi forte que pendant son interdiction.
L’histoire des drogues, du 19ème siècle avec les fumeries d’opium, aux années d’après-guerre où des figures comme Cocteau étaient des opiomanes connus, démontre que cet attrait pour les “produits transgressifs” n’est pas nouveau. L’opium, l’héroïne, et plus récemment le cannabis et la cocaïne, ont généré des économies florissantes, créant des circuits parallèles de financement et d’échanges occultes. Certains pays comme le Maroc ou l’Afghanistan dépendent même de ces cultures, qui agissent comme de véritables régulateurs de leur économie et de leur équilibre politique. Le Fonds Monétaire International l’a clairement indiqué : si la Colombie cessait de produire de la cocaïne, son économie s’effondrerait.
En France, le cannabis reste la drogue la plus répandue, mais la cocaïne “se démultiplie” et se démocratise, touchant désormais tous les milieux. Autrefois associée aux milieux artistiques ou privilégiés, car considérée comme une “drogue propre” contrairement à l’héroïne, elle est désormais présente partout. L’héroïne, elle, a laissé des souvenirs terrifiants à Colombies : un monde de toxicomanes qui “vivait dans des conditions épouvantables”, car la drogue se substituait à l’alimentation et devenait le seul mode de vie de l’individu, poussant à la prostitution et aux actes criminels pour obtenir sa dose.
La cocaïne, ultra-stimulant héritier de drogues de synthèse développées avant-guerre comme la Pervitine, qui supprimait la fatigue et donnait une sensation d’hyperpuissance, est particulièrement prisée dans les milieux qui prônent “le culte de l’hyperperformance”. Traders, économistes, cadres, et même certains politiciens, usent de ces produits pour être “toujours sur tous les fronts”. Le cannabis, lui, est un “déstressant”, un “usage un peu thérapeutique”, mais non sans conséquences, pouvant révéler des névroses et des phénomènes schizophréniques.
Le quotidien du flic de stups : un fil tendu sur le rasoir
Le quotidien d’un policier des stups est “un monde à part”, où l’on baigne à temps plein dans l’univers “le plus pourri” : toxicomanes, dealers, prostituées. Le grand danger, explique Colombies, est de “considérer que ça devient la normalité”, de perdre pied. La famille reste le seul “raccrocheur à la vie réelle”. Il a vu des collègues “tomber dedans”, consommant eux-mêmes, un “piège mortel” dans lequel il déconseille aujourd’hui à quiconque de s’aventurer.

L’invisibilité est la règle d’or : pas de badge, pas d’arme visible, le flic des stups doit passer “le plus inaperçu possible”, passant “90 % de notre temps en filature ou en planque”. Le film “L.627” de Bertrand Tavernier décrit parfaitement cette ambiance, avec l’obligation d’avoir des indics, ces informateurs issus du milieu, souvent toxicomanes ou dealers. Obtenir des renseignements d’un indic est un art complexe, car les flics n’ont pas les moyens de les rémunérer correctement. Les primes sont “ridicules” comparées aux sommes brassées par le trafic. Les douanes, elles, bénéficient d’un système de rémunération tarifé et de la possibilité de “taxer” fiscalement les trafiquants, offrant une monnaie d’échange que les policiers n’ont pas.
Cela pousse les policiers à “négocier” avec les indics, à “donner en donnant”. Soit en leur laissant une part du produit, soit en leur fournissant des doses. “La frontière de ne pas devenir le copain de l’indic est extrêmement compliquée”, explique Colombies, et c’est là que “des flics ont basculé”. Autrefois, la hiérarchie fermait les yeux sur ces pratiques, une sorte de “gentleman agreement”. Mais un jour, “c’est fini, on ne vous couvrira plus”, a-t-on annoncé. Une décision qui, si elle met fin à une pratique dangereuse, rend la résolution des affaires “très compliquée” pour les policiers actuels.
L’hypocrisie de l’État : un combat perdu d’avance ?
Jean-Pierre Colombies dénonce une “hypocrisie absolue” de l’État qui ne donne pas les moyens aux policiers de lutter efficacement. Il faudrait des “primes conséquentes pour les indics”, des “moyens logistiques”, “plus de magistrats”, et surtout “améliorer leur formation, améliorer leur protection”. Il critique l’absence du ministre de la Santé dans le triptyque de la lutte contre les stupéfiants (Intérieur, Justice, Santé), alors que la consommation de drogues répond souvent à un “problème de mal-être” dans une “société anxiogène”. Pour lui, l’État a “renoncé à lutter efficacement” contre ce fléau.
“Escobar disait à l’époque : ‘Moi, je vends ce qui s’achète’”, rappelle Colombies. La vraie question n’est pas d’envoyer des dealers en prison, mais de comprendre “pourquoi il y a une telle demande” et comment “neutraliser cette demande” par la “médication” et une approche sociale. Car le trafic s’adapte : des “points de deal” délocalisés, l’émergence de l’UberShit, et des ventes qui se font désormais sur les réseaux sociaux comme WhatsApp. Marseille, ville portuaire ouverte sur le Maghreb, est un exemple criant de cette démesure, avec des “containers entiers qui arrivent remplis de cannabis”. Dans les années 80, on estimait le passage journalier à “5 tonnes de cannabis” rien qu’en Espagne.
La “guerre à la drogue” telle qu’elle est menée est “juste illusoire” et destinée aux “médias mainstream”. Le problème est “un problème de fond, un problème de société”. Sans une approche globale, incluant la prévention, le soin et une refonte du système judiciaire et policier, les “grenades dégoupillées” continueront d’exploser, et “rien n’aura changé”. Les confessions de Jean-Pierre Colombies sont un rappel brutal et nécessaire des défis titanesques auxquels notre société doit faire face pour espérer sortir de l’ombre de ce monde “pourri” des stups.
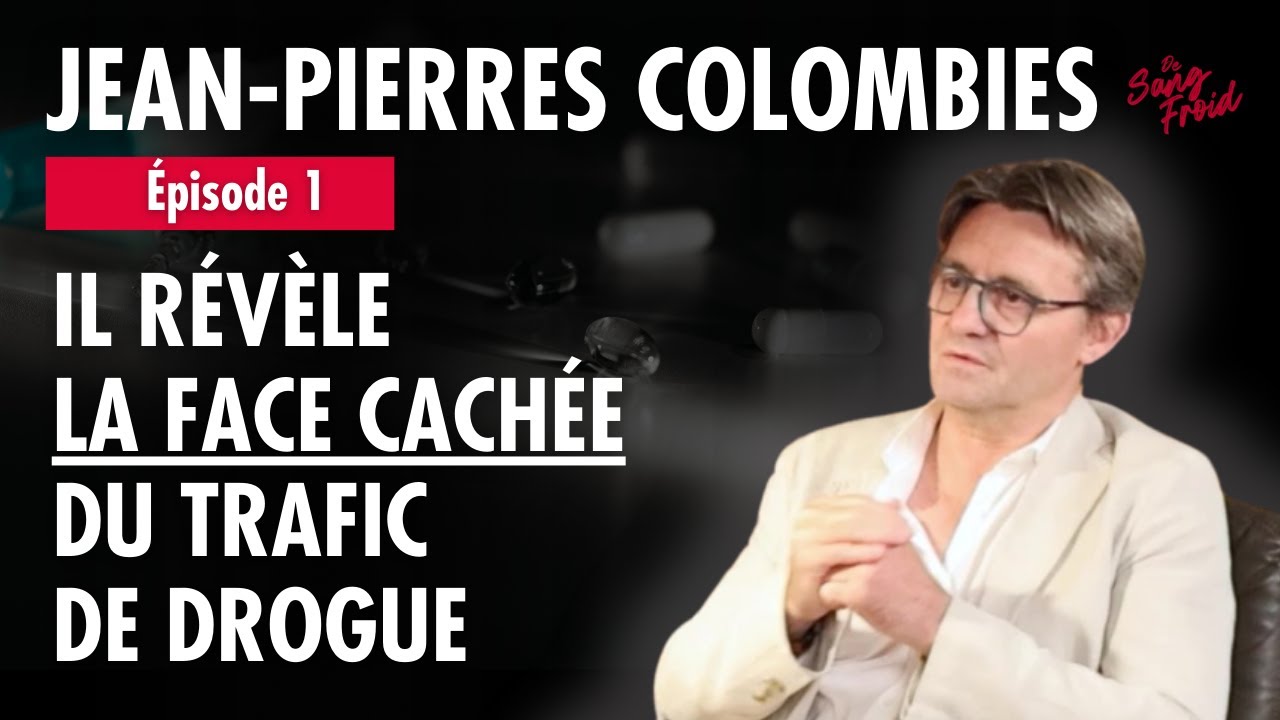
News
Nolwenn Leroy : Les Révélations Poignantes de ses 42 ans sur “l’Amour de sa Vie”
Dans l’univers parfois impitoyable du show-business français, rares sont les artistes qui parviennent à maintenir une frontière étanche entre les…
Julio Iglesias à 81 ans : Entre aveux sincères, secrets de famille et vérité sur sa santé, la légende se livre enfin
Julio Iglesias n’est pas seulement une voix ; il est un mythe vivant, une icône de la romance qui a…
Isabelle Nanty : Le combat secret d’une icône entre la vie et la mort après une hospitalisation critique
Le monde du cinéma français a retenu son souffle. Isabelle Nanty, figure emblématique et solaire de nos écrans, a traversé…
CLASH EXPLOSIF : Louis Boyard et Apolline de Malherbe, le duel qui a embrasé le direct !
L’arène médiatique a tremblé ce matin. Ce qui devait être une interview politique classique s’est transformé en un véritable champ…
Jean-Pierre Foucault en deuil : Les adieux déchirants à Marie-José Tramoni, la seule femme qu’il ait jamais épousée
Le paysage médiatique français est en émoi. Derrière l’image de l’animateur infatigable, toujours prêt à distribuer sourires et bonne humeur…
Sarah Knafo “rhabille” la gauche : le choc des vérités sur le Venezuela !
Le séisme politique : Sarah Knafo face à l’aveuglement idéologique Le paysage médiatique français vient d’être le théâtre d’une déflagration…
End of content
No more pages to load












