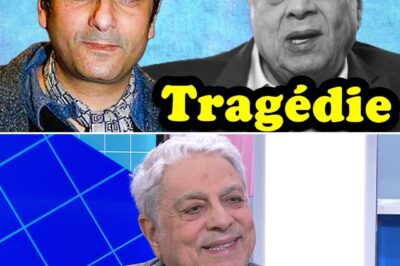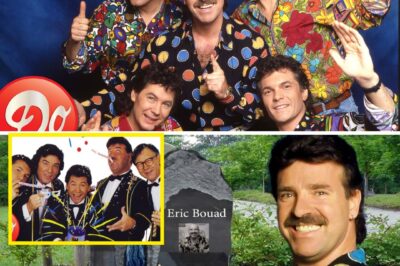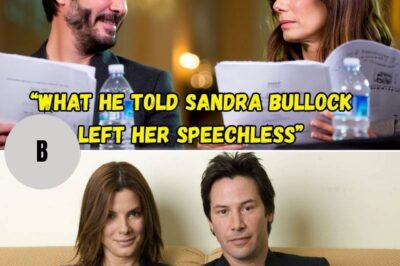Fabrice Nicolino, journaliste en colère qui rêve d’un 1789 écologique
/2025/01/03/maxnewsworldfour909609-677822b07afe5674863252.jpg)
Pionnier du journalisme environnemental, révolutionnaire revendiqué et survivant de l’attentat de Charlie Hebdo, Fabrice Nicolino fait bande à part avec la gauche et les écolos. Un engagement à rebours de l’intersectionnalité en vogue dans les luttes actuelles.
« Je suis pour la révolution. Je l’ai été toute ma vie et je le suis encore. Pour un 1789 écologique. » Voici la ligne directrice. Celle à laquelle on se raccrochera au cours de ces longues heures d’échanges passionnants, parfois contradictoires, souvent déroutants, avec Fabrice Nicolino.
À bientôt 70 ans — il sera septuagénaire en août —, ce pionnier du journalisme environnemental a eu le temps de cumuler les amertumes et les désillusions. Elles se mélangent chez lui à une ferveur restée brûlante, dans un bouillonnement qui rend le personnage difficile à cerner. Journaliste ? « Un métier qui m’a énormément déçu. » De gauche ? « J’ai totalement rompu avec la gauche, en pleine perdition morale et politique. » Anarchiste, tout de même ? « Si tu tiens absolument à me définir, oui, si tu veux. »
Auteur, en tout cas, et prolifique. Dans le dernier des dizaines d’ouvrages qu’il a signés, C’est l’eau qu’on assassine (Les Liens qui libèrent, 2025), il revient sur l’effarante quantité de polluants qui empoisonnent nos rivières, nappes souterraines, océans, et dénonce l’agrochimie et les industries « criminelles » qui nous contaminent, bénéficiant de la défaillance, voire de la complicité de l’État.
« Il n’y a, au fond, plus qu’un seul sujet qui compte : le dérèglement climatique. Il porte la menace très concrète de la dislocation des sociétés humaines », dit Fabrice Nicolino. © Jean-Marie Heidinger / Reporterre
Le ton tour à tour pamphlétaire, journalistique et militant est un étrange mélange des genres, à l’image de son auteur. Au risque de brouiller le message ? Peu importe pour Nicolino, dont le seul combat, l’obsession, est celle de l’urgence écologique. « Il n’y a, au fond, plus qu’un seul sujet qui compte : le dérèglement climatique. Il porte la menace très concrète de la dislocation des sociétés humaines. »
L’art de s’engueuler avec tout le monde
Tout autre enjeu ne vaut qu’à travers le prisme de cette priorité absolue, quitte à choquer. « Je me suis engueulé toute ma vie avec à peu près tout le monde », dit-il.
Cas emblématique : celui de Politis, où Fabrice Nicolino était chroniqueur depuis la fondation du média, en 1989. En 2003, lorsque survint le débat sur la réforme des retraites, il critiqua vertement les syndicalistes et opposants à la réforme, dénonçant « l’hyperconsommation » des retraités et « ceux qui se battent pour le maintien de leur situation personnelle, souvent privilégiée sur le plan personnel, sans remettre en cause nos manières concrètes de vivre et de gaspiller ».
Le tollé et le clash suscités avec ses collègues le poussèrent dans la foulée à quitter le journal. « Je ne regrette pas une seconde », dit-il aujourd’hui, la voix forte d’une passion inaltérée. Même s’il assure avoir « conscience, évidemment, qu’il y a des gens qui souffrent dans un pays comme la France. Mais, globalement, le Nord a déjà trop pris de ressources. »
La bibliothèque de Fabrice Nicolino fourmille d’ouvrages ornithologiques. © Jean-Marie Heidinger / Reporterre
La question sociale, pourtant, il l’a connue intimement pour avoir grandi, dans les années 1950 et 1960, en Seine-Saint-Denis, et notamment dans la cité des Bosquets, à Montfermeil. « Une banlieue pourrie » où il baigna dans un milieu violent, « très déstructuré, très bordélique ».
Sa mère et sa sœur fréquentaient des « truands » et la police débarquait régulièrement à la maison. Son père est mort lorsqu’il avait 8 ans, après avoir trimé comme ouvrier, dix heures par jour, six jours par semaine.
« Il était communiste, stalinien. Mais je l’aimais énormément. » Le jeune Fabrice, quatrième d’une fratrie de cinq, s’est donc élevé tout seul et, très vite, s’est raccroché « au lyrisme révolutionnaire » pour mettre du sens sur son monde chaotique. À l’adolescence, il fréquentait la Ligue communiste révolutionnaire, rêvait d’un affrontement armé contre la société et participait aux bastons contre « les flics et les fachos ».
Fabrice Nicolino était présent dans les combats antifascistes des années 1970. © Jean-Marie Heidinger / Reporterre
L’envie d’en découdre le poussa toujours plus loin. Il fut des violents affrontements parisiens du 21 juin 1973, contre la réunion publique du mouvement d’extrême droite Ordre nouveau à la Mutualité et la police qui le protégeait. Il soutint les mouvements révolutionnaires partout dans le monde, d’abord depuis Paris, puis sur place. À la fin des années 1970, il rejoignit le Nicaragua, en pleine révolution sandiniste.
Lorsqu’on l’interroge sur cette période, le regard devient fuyant. Il préfère qu’on n’en parle pas trop. Il faut dire que la désillusion fut, une fois de plus, brutale. Le leader révolutionnaire, Daniel Ortega, prit le pouvoir pour ne plus le lâcher. « C’est un dictateur féroce et un mec vraiment horrible. La violence a toujours été un truc important dans ma vie. J’ai appris que c’était un jeu terriblement dangereux », dit-il tout bas.
Rescapé de deux attentats
Il est donc temps d’évoquer l’éléphant dans la pièce. Les deux attentats dont il a été victime. Une première fois, en 1985, il a réchappé à la bombe qui a explosé dans le cinéma parisien Rivoli-Beaubourg, qui ciblait un festival international du cinéma juif. Puis le 7 janvier 2015, il a survécu à l’attaque de Chérif et Saïd Kouachi, les assaillants islamistes des locaux de Charlie Hebdo, qui a emporté nombre de ses amis.
Une balle dans chaque jambe et une autre dans l’abdomen lui ont laissé les nerfs en bouillie et des séquelles à vie. Inévitablement, aussi, un impact sur sa vision du monde ? « Pas tant que ça. Les jeux étaient déjà faits depuis longtemps », assure-t-il.
Pour Fabrice Nicolino, les religions conservent, « intrinsèquement, une visée totalitaire ». Et les discriminations subies par les musulmans en France n’y changent selon lui rien. © Jean-Marie Heidinger / Reporterre
De quoi renforcer, au minimum, sa haine viscérale contre toute forme de totalitarisme. Les errements historiques staliniens ou maoïstes d’une partie de la gauche française lui valent sa rancœur indélébile. Et son hostilité vis-à-vis des religions qui ont, selon lui, « intrinsèquement, une visée totalitaire », l’ont placé en première ligne des échanges houleux qui ont opposé Mediapart et Charlie Hebdo. Le premier journal reprochant au second la « diabolisation de tout ce qui concerne l’islam et les musulmans ».
Et ne vous avisez pas de souligner que les musulmans sont une population discriminée en France aujourd’hui, et que critiquer la religion des dominants ou des dominés n’a pas les mêmes implications. « Pardon mais c’est tellement con… enchaîne-t-il. Quand j’étais jeune, il fallait, à gauche, se prosterner devant tout ce que disait un ouvrier. Aujourd’hui c’est les musulmans, c’est tout aussi ridicule. »
Fabrice Nicolino vit désormais dans une petite maison loin de Paris, où les bibliothèques prennent une large place. © Jean-Marie Heidinger / Reporterre
Lorsqu’on se montre perplexe, le ton devient sévère, péremptoire. Et flirte avec une dangereuse islamophobie qui lui vaut une partie des clashs dont il est coutumier. En marge de l’affrontement contre Mediapart, Fabrice Nicolino s’est aussi brouillé avec Arrêt sur images, média où il fut éphémère chroniqueur, en 2017.
« C’est évidemment l’écolo historique et sans concession, que nous avons recruté. Pas l’éclopé du 7 janvier 2015. J’ai voulu croire qu’on pourrait dissocier les deux », écrivait Daniel Schneidermann, le fondateur d’Arrêt sur images en novembre 2017, avant de déplorer l’obsession du moment de Nicolino à ferrailler contre l’islamisme et Mediapart plutôt que de parler de l’urgence écologique ou du combat pour les minorités.
Sur son blog, Fabrice Nicolino livrait lui-même les coulisses de cette empoignade et prenait acte de ce « licenciement sans préavis ». Le fossé est depuis devenu abyssal entre la vision de celui qui est toujours fidèle à Charlie Hebdo, et celle des médias de gauche qui documentent la montée de l’islamophobie en France.
« Je ne suis pas écolo, ça ne colle pas du tout à ma vision des choses »
De fait, sur beaucoup d’autres sujets, ses positions intransigeantes coupent Fabrice Nicolino des combats actuels d’une partie de la gauche. Alors que les luttes écologistes sont de plus en plus indissociables des combats antifascistes, antiracistes, écoféministes et LGBTQI+, lui assume une position aux relents conservateurs basée sur le rejet des revendications intersectionnelles. « Ça m’insupporte, dit-il. J’ai connu ça aussi dans les années 1970 : on vise une pureté idéologique qui critique, admoneste, congédie, prétend tout savoir sur tous les sujets et divise au lieu de rassembler. »
Là encore, on tique. Aux antipodes de l’écologie populaire, féministe et décoloniale qu’explore notamment Reporterre, une préoccupation en silo pour le climat et le vivant, ressemble davantage à un environnementalisme à l’ancienne qu’à un combat écologiste. Lui récuse d’ailleurs le terme d’écologiste : « Je ne suis pas écolo, ça ne colle pas du tout à ma vision des choses. »
Hostile aux chemins que prennent aujourd’hui les combats pour l’égalité, le vieil anarchiste rêve étonnamment d’une forme apolitique d’union des peuples aujourd’hui. Lui qui fut de tous les combats écologistes, qui rejoignit le Larzac à 16 ans, en 1971, qui revendique d’avoir été le premier à médiatiser, en 2007, la lutte contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, est convaincu que le péril écologique peut réunir les gens au-delà des clivages. Le succès du mouvement contre les pesticides, Nous voulons des coquelicots, qu’il a lancé en 2018 en refusant sa politisation, le conforte dans cette idée.
Fabrice Nicolino est l’une des deux personnes à l’origine de l’Appel des coquelicots de septembre 2018 pour l’interdiction des pesticides de synthèse. © Jean-Marie Heidinger / Reporterre
Ne le qualifiez pas non plus de décroissant, terme trop clivant, trop associé au parti écologiste qu’il rejette, comme toutes les organisations politiques. Les multiples paradoxes sont assumés chez cet homme devenu non violent tout en prônant la « destruction des multinationales » et celle du capitalisme. Qui plaide pour unir tout le monde face au péril climatique, tout en dézinguant à tout-va la gauche, les luttes intersectionnelles, les religions ou encore les grandes ONG environnementales, dont il dénonce les accointances avec le monde industriel.
Croit-il vraiment la victoire possible ? Lorsqu’on lui pose la question, il élude et soupire. Se déclarant « très attaché à une tradition de vaincus de l’histoire », il cite, parmi ses sources d’inspiration, Louise Michel, figure de la Commune de Paris, Nestor Makhno, révolutionnaire libertaire ukrainien, qui s’opposa à la fois aux armées tsaristes et à l’armée rouge bolchevique, ou encore Buenaventura Durruti, anarchiste espagnol emporté par la guerre civile de 1936. « Ces personnages étaient partisans de la violence. Mais je vénère encore leur geste aujourd’hui, car elle contient l’esprit de révolte qui n’existe presque plus en France », déplore-t-il.
« Je balancerais tout à la poubelle, pour un seul ver de terre, une seule sauterelle, une seule goutte d’eau. » © Jean-Marie Heidinger / Reporterre
L’esprit de révolte reviendra peut-être, il veut l’espérer. Il cultive en attendant aussi l’esprit de contemplation et l’amour de la nature. Les ouvrages ornithologiques sont légion dans ses bibliothèques. Celles-ci couvrent tous les murs de sa petite maison, cachée quelque part dans l’ouest, à l’abri de la fureur parisienne et des menaces.
Avant de nous séparer, il cite en souriant Pasolini, qui écrivait être prêt à tout donner « pour une seule luciole ». « C’est mon sentiment profond. Je balancerais tout à la poubelle, pour un seul ver de terre, une seule sauterelle, une seule goutte d’eau. »
Pour sauver la beauté incommensurable des rivières et des forêts — plus encore que pour les humains, sans doute —, il n’imagine pas un seul instant arrêter le combat. Et projette encore d’écrire des livres. « Je ne sais pas quoi faire d’autre. »
News
“Révélation choquante : La famille d’Enrico Maias brise enfin le silence sur son état de santé dévasté, et ce que son fils révèle sur la lutte de la légende contre la maladie va bouleverser à jamais l’histoire de la musique !” EN SAVOIR PLUS👉👉
“Révélation choquante : La famille d’Enrico Maias brise enfin le silence sur son état de santé dévasté, et ce que…
Salut Les Musclés (1989–1994) : Un par un, ils s’en vont – Le groupe s’est séparé😞😞 EN SAVOIR PLUS👉👉
Salut Les Musclés (1989–1994) : Un par un, ils s’en vont – Le groupe s’est séparé Il est des génériques…
Keanu Reeves révèle enfin son amour pour Sandra Bullock après 30 ans – et c’est plus déchirant qu’on ne le pensait😍😍 EN SAVOIR PLUS👉👉
Keanu Reeves Finally Reveals His Love for Sandra Bullock After 30 Years—and It’s More Heartbreaking Than We Thought For decades,…
Eddy Mitchell, 83 ans, comment va-t-il vraiment? Un ami humoriste célèbre brise le silence: nouvelles rassurantes, «la bête est solide», frayeur dissipée, rumeurs balayées, retour en scène évoqué, émotion des fans, confidences exclusives, soirée télé virale, soulagement national, partagé massivement. EN SAVOIR PLUS👉👉
Eddy Mitchell, 83 ans, comment va-t-il vraiment? Un ami humoriste célèbre brise le silence: nouvelles rassurantes, «la bête est solide»,…
Un enfant est vraiment un cadeau : M. Pokora partage avec joie le tendre cadeau d’anniversaire offert par ses trois petits trésors🥰🥰 EN SAVOIR PLUS👉👉
Un enfant est vraiment un cadeau : M. Pokora partage avec joie le tendre cadeau d’anniversaire offert par ses trois…
Mimie Mathy, notre “Joséphine, ange gardien” adorée, vient de briser un silence assourdissant, révélant un état de santé qui plonge le pays entier dans l’inquiétude…. EN SAVOIR PLUS👉👉
Mimie Mathy, notre “Joséphine, ange gardien” adorée, vient de briser un silence assourdissant, révélant un état de santé qui plonge…
End of content
No more pages to load