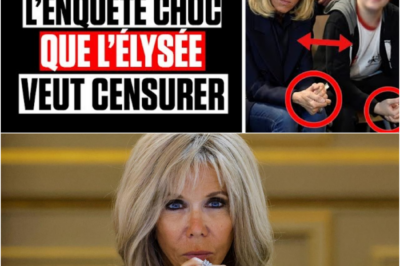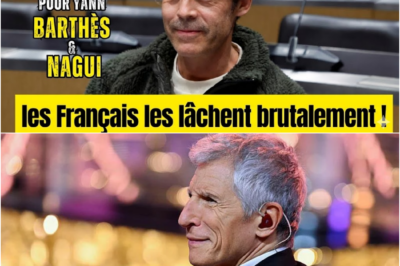« Mon fils polyhandicapé était dangereux pour lui-même » : La Souffrance Aiguë, les Larmes sous la Douche et la Séparation Salvatrice d’Églantine Éméyé.
Par Eddy Lefranc, Chroniqueur Culture & Société
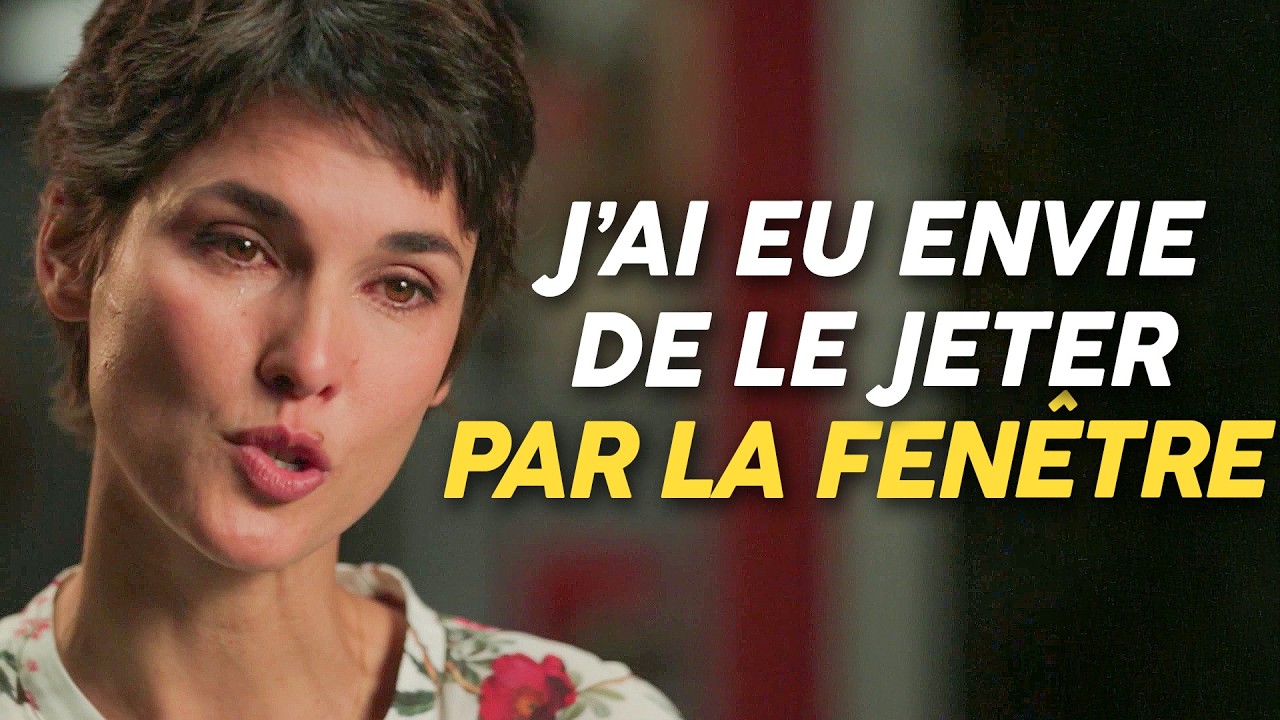
Églantine Éméyé, visage familier et solaire du petit écran français, a longtemps été une figure de courage en racontant le calvaire de sa vie privée. Pourtant, ses récentes confidences ont ébranlé l’opinion publique, dépassant les limites de la simple compassion pour atteindre celles de l’effroi et de la compréhension profonde. Dans un documentaire poignant et des entretiens sans filtre, Églantine a levé le voile sur le « cauchemar » de mère d’un enfant polyhandicapé, Sami, révélant la violence d’une lutte menée de jour comme de nuit.
La confession la plus sidérante n’est pas celle de la douleur, mais celle de l’épuisement ultime et du désespoir : « Il m’est arrivé d’avoir envie de le jeter par la fenêtre et moi avec ». Cette phrase n’est pas un rejet affectif, mais le cri d’une mère à bout, confrontée à une « violence nocturne incroyable » et à un enfant qui était, par son mal, un danger permanent pour lui-même. Cet article explore le parcours d’Églantine Éméyé, de la lutte incessante contre la maladie innommable de son fils à la décision de rupture, douloureuse mais nécessaire, qui a fini par apporter le soulagement.
I. Le Mal « Innommable » : Une Vie de Cris et d’Auto-Destruction
Sami, le fils d’Églantine, souffre d’un mal qui est la somme de plusieurs diagnostics : épilepsie, accident vasculaire cérébral, autisme, et finalement polyhandicap. Il s’agit d’un « mal incurable et innommable » qui le prive de toute capacité d’expression conventionnelle ou d’autonomie.
La vie de Sami est une torture physique et mentale. Incapable de s’exprimer comme les autres, toute sa communication passe par « des hurlements ». Il ne marche pas, ne mange pas, n’est pas propre, est « incapable en fait de faire quoi que ce soit tout seul ». Le plus terrifiant est son comportement d’auto-destruction. Sami s’auto-frappait violemment, se blessait, avait le visage et les mains constamment meurtris au point que « les joues n’avaient plus le temps de cicatriser ». Il cherchait les « arêtes des murs pour aller se cogner le dos », et s’il ne trouvait rien, il frappait contre les fenêtres, en brisant certaines.
La période entre 3 et 7 ans fut « le pire du pire ». Sami ne dormait jamais, obligeant sa mère à une vigilance constante. Églantine explique qu’il est « un enfant qui ne mesure pas encore aujourd’hui » le danger. Il est capable de prendre un couteau, de confondre une éponge avec un gâteau, et « attrape ce qui est à sa portée sans mesurer une seconde le danger ». L’impossibilité de le laisser seul « 5 minutes sans surveillance » et son insomnie ont transformé la vie d’Églantine en une course folle.
II. L’Amour Maternelle à Sens Unique et les Solutions de Dernier Recours
L’épuisement physique s’est doublé d’un effondrement psychologique profond. Églantine confie que son amour pour Sami est « viscéral », mais qu’il est la preuve qu’un amour maternel peut être « à sens unique ». Sami ne lui renvoyait aucun signe d’affection. Il ne la regardait pas, hurlait, n’allait jamais vers elle.
Quand il se faisait mal, son instinct la poussait à le consoler, mais il « hurlait, il se frappait », l’empêchant de le toucher. « Tout ça vous remet complètement en cause dans votre rôle de mère ». Elle avait l’impression que « quoi que je fasse de toute façon ça n’allait pas ». Pendant longtemps, elle fut persuadée de n’être à ses yeux qu’une « machine à lui fournir à manger, à boire et des médicaments ». Cette quête perdue du contact, du regard qui reconnaît, était la plus grande douleur, dépassant même les cris.
Pour protéger Sami de lui-même, Églantine a dû imaginer des solutions extrêmes. Refusant la « camisole chimique » (la sur-médicamentation), elle a fait confectionner une sorte de « camisole » physique : un sac de couchage où elle bloquait ses mains et ses jambes, ne laissant que la tête libre, pour l’empêcher de s’auto-mutiler la nuit. Bien que ce ne fût pas un miracle, l’immobilité finissait par le rendre « moins longtemps énervé ». Elle utilisait aussi des gants molletonnés d’Aïkido, ramenés par sa belle-sœur japonaise, pour amortir les coups.
Le couple n’a pas survécu à cette épreuve. C’est Églantine qui est partie, ne pouvant « tout gérer à la fois ». Elle cite une statistique effrayante : « 80 % des familles avec handicap sont des familles monoparentales ».
III. Les Larmes Secrètes et la Nécessité de Travailler

Animatrice de télévision, Églantine a dû maintenir un « joli sourire » en public. Elle avait un rituel secret pour gérer les « effondrements terribles » : « quand vraiment je craque, je me mets sous la douche et je pleure un bon coup ». C’était le seul espace de solitude pour évacuer la détresse.
Travailler était « indispensable » pour elle à deux niveaux. D’abord, pour des raisons financières : « un enfant handicapé, on n’imagine pas ce que ça coûte au quotidien », les aides étant « jamais à la hauteur » des besoins (orthophonie, kiné, psychologues, etc.). Ensuite, pour sa survie psychologique : elle « admir[e] celles qui le font », mais ne se voyait pas être la « thérapeute au quotidien » de son fils et « ne vivre que du handicap de [son] fils ». Elle voulait garder sa curiosité, son envie de vivre, son « moi ».
IV. La Décision Salutaire : « Il Est Mieux Là-Bas Qu’avec Moi »
Il y a deux ans, Églantine Éméyé a pris la décision la plus déchirante de sa vie : placer Sami dans un établissement hospitalier spécialisé à Saint-Barthélemy d’Anjou, à 700 km de chez elle.
La chose la plus difficile à comprendre est qu’« un enfant est mieux loin de vous qu’avec vous ». Églantine a réalisé qu’elle était épuisée. Les « armes » qu’elle pouvait lui donner pour qu’il soit mieux n’étaient « malheureusement pas chez moi », mais dans une structure avec des professionnels qui possédaient « une distance, une générosité, un savoir-faire que je n’étais plus capable d’avoir ». Elle conclut : « Il est mieux aujourd’hui là-bas qu’avec moi ».
Dans cet établissement, Sami a bénéficié d’une thérapie décriée mais efficace dans son cas : le « Packing ». Bien que cela puisse paraître « monstrueux » sur le papier (envelopper l’enfant dans un drap froid et humide à 10°C, puis le serrer et le réchauffer aussitôt), Églantine témoigne de son efficacité. Le traitement détend Sami, lui offre un « regard très coordonné » et le rend « disponible à tout ce qui se passe autour de lui ».
Aujourd’hui, Sami dort, émet des sons et semble manifester qu’il reconnaît sa mère. Églantine descend le voir tous les quinze jours, pour deux jours entièrement dédiés à lui. Même si Sami ne manifeste pas clairement son malheur de la voir partir, elle se console en se disant qu’elle préfère « ne pas lui manquer » pour éviter la souffrance de la séparation.
V. L’Étreinte du Bonheur et le Combat contre l’Injustice

Malgré la paix retrouvée, Églantine porte en elle « un cri » contre l’injustice. Si le handicap n’est la faute de personne, elle regrette et dénonce le fait qu’on soit « si mal aidé », soulignant un « parcours » exténuant pour obtenir de l’aide.
Églantine refuse de se projeter dans l’avenir : « Je déteste cette question. Je n’imagine pas. Je n’ai pas envie de savoir. J’avance au jour le jour ».
Pourtant, après toutes ces années sombres, une lueur de bonheur a émergé. Elle n’aurait jamais imaginé passer « 15 jours d’été avec un Sami souriant, facile, rentrant dans des magasins sans hurler ». Cela s’est produit en juillet dernier. « J’ai eu l’impression de faire connaissance de mon fils ». Cet enfant joyeux, elle ne l’avait jamais connu en 10 ans.
Le témoignage d’Églantine Éméyé est un puissant plaidoyer en faveur de la reconnaissance de l’épuisement maternel et du besoin criant de structures adaptées. C’est l’histoire d’une mère qui, après avoir été au bord du gouffre, a trouvé le salut non pas en s’accrochant à son enfant, mais en acceptant de le laisser partir. Son cri d’alarme contre l’injustice des aides résonne aujourd’hui, obligeant la société à regarder en face le fardeau invisible que portent des milliers de familles dans la solitude.
News
Affaire Brigitte Macron : Lionel Labosse lâche une bombe de 900 pages et dénonce “l’omerta d’État” sur le plus grand tabou de la Ve République
C’est un pavé dans la mare, ou plutôt un rocher lancé en pleine vitrine de la macronie. Dans un paysage…
Brigitte Bardot et la petite-fille invisible : Enquête sur le secret le mieux gardé d’une famille qui a choisi l’effacement
C’est une énigme qui défie les lois du “star-système”, un vide sidéral au cœur d’une galaxie médiatique pourtant saturée d’images….
Pascal Praud atomise François Hollande : Quand la “France d’en bas” règle ses comptes avec l’arrogance d’une élite faillie
C’est une séquence qui restera gravée dans les annales de la télévision et, peut-être, dans l’histoire politique de notre pays….
Nagui et Yann Barthès, la chute des idoles : Pourquoi les Français rejettent massivement les “donneurs de leçons” de la télévision
C’est un séisme médiatique, une secousse tellurique qui fait trembler les fondations mêmes du petit écran français. Le verdict du…
Nagui, le clown triste : Quand Mélanie Page révèle enfin la “tragique vérité” et les blessures secrètes de l’animateur préféré des Français
C’est une confession qui résonne comme un coup de tonnerre dans le ciel serein du paysage audiovisuel français, une de…
Brigitte Bardot et le “fils maudit” : Bernard d’Ormale révèle enfin la brutale vérité sur une maternité sacrifiée
C’est une histoire qui hante les coulisses du cinéma français depuis plus de soixante ans, une ombre tenace planant sur…
End of content
No more pages to load